1) Historique
1.1) Les précurseurs et les autres
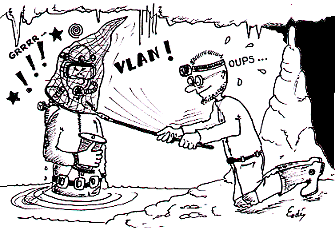 La spéléologie biologique est l'étude du
monde vivant à l'intérieur des cavités terrestres
(ou hypogé). Cette discipline scientifique, branche de la zoologie
liée à la spéléologie, porta tout d'abord
le nom de biospéléologie (Armand VIRÉ 1895),
puis fut rebaptisée biospéologie (Armand VIRÉ
1904, Émile Georges RACOVITZA 1907) : c'est ce vocable qui
sera finalement retenu.
La spéléologie biologique est l'étude du
monde vivant à l'intérieur des cavités terrestres
(ou hypogé). Cette discipline scientifique, branche de la zoologie
liée à la spéléologie, porta tout d'abord
le nom de biospéléologie (Armand VIRÉ 1895),
puis fut rebaptisée biospéologie (Armand VIRÉ
1904, Émile Georges RACOVITZA 1907) : c'est ce vocable qui
sera finalement retenu.
La première attestation d'une observation par l'homme d'animaux
cavernicoles date du Magdalénien moyen (environ 15000 ans)
: le Comte BÉGOUEN a en effet découvert dans la grotte
des Trois-Frères en Ariège, un os de bison gravé
sur lequel on peut reconnaître un Troglophilus (espèce
de sauterelle troglobie). Historiquement, le premier être vivant
cavernicole qui fit l'objet d'une description écrite fut le
protée, un vertébré (batracien urodèle)
proche parent des salamandres. Découvert dans une grotte de
Yougoslavie, dans la région de la Carniole par le baron Johan
WEICHARD VON VALSAVOR, il sera cité dans une publication éditée
en 1689 à Laibach (Lubjana). Ensuite des cavernicoles terrestres
seront découverts et étudiés dans la caverne
de Postumia (Adelsberg) comme les Leptodirus en 1831 par Franz VON
HOHENWART. Les premiers cavernicoles découverts en France le
furent en 1857 dans les Pyrénées Ariégeoises
par Ch. LESPES. Plus tard, grâce à Édouard Alfred
MARTEL et à ses nombreuses explorations, la vocation de biospéologue
vint à son compagnon Armand VIRÉ qui installa même
le premier laboratoire souterrain dédié à la
biospéologie dans les catacombes sous le Jardin des Plantes
à Paris (1896 / 1910)
D'autres grands noms ont marqué depuis cette discipline (par
ordre alphabétique) :
Pierre Alfred CHAPPUIS
Claude DELAMARE-DEBOUTEVILLE
Carl EIGENMANN
Louis FAGE
René JEANNEL
Curt KOSSWIG
Albert VANDEL
Quand on sait que le célèbre Théodore MONOD
lui-même, étudia les animaux cavernicoles et publia des
articles à leur sujet (Thermosbanea mirabilis, 1927, in Faune
des colonies françaises), on comprendra aisément que
la bibliographie citée
en fin d'article ne soit qu'une infinitésimale parcelle de
ce qui a été publié à ce jour dans le
domaine.
1.2) Premier essai de classification des cavernicoles
La première tentative de classification des animaux hypogés
(vivant sous terre) a été publiée en 1849 par
J. C. SCHIÖDTE dans un ouvrage intitulé Specimen Faunae
Subterraneae. Cette première tentative de classification était
basée sur la zone occupée par les animaux dans les cavernes
: ombre, obscurité totale ou partielle, concrétions.
Une modification sensible sera apportée par J. R. SCHINER en
1854 dans un article sur les grottes d'Adelsberg. Il introduira la
dénomination de troglobie pour les animaux vivant exclusivement
dans les grottes, il appellera troglophiles ceux qui n'y sont pas
totalement liés et enfin hôtes occasionnels tous les
autres.
Depuis on a conservé les termes donnés par RACOVITZA
en 1907 : troglobies, troglophiles et trogloxènes (pour
des détails se reporter au 2.2 ou au
2.3). Il est important de noter que cette classification n'a rien
de systématique ni de phylogénétique : elle regroupe
dans chacune des trois catégories des ensembles très
divers d'animaux. Ce tri, basé uniquement sur des considérations
écologiques, est pourtant suffisamment pratique pour qu'on
l'utilise toujours.
 |
2) A part des spéléos, qu'y a-t-il
de vivant sous terre ?
2.1) Le monde souterrain : lieu de vie.
On ne peut pas donner de description générale et universelle
des caractères particuliers à la vie souterraine, car
les grottes et leur climat sont bien différents suivant les
latitudes ou l'altitude à laquelle elles s'ouvrent. Ces différences
sont d'autant plus sensibles qu'on est proche de l'entrée ou
de la surface. Pourtant au fur et à mesure que l'on s'enfonce
sous terre et dans les régions tempérées du globe
on retrouve des caractéristiques communes.
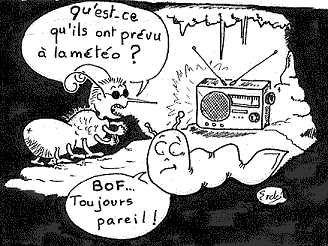 OBSCURITÉ : seul point commun à toutes les grottes
du globe, passé quelques dizaines de mètres de l'entrée
(distance variable suivant la topographie de la cavité) l'absence
de lumière y est totale. Rien à voir (c'est le cas de
le dire) avec une nuit sans lune. Tout spéléo en a fait
un jour l'expérience, amusante si elle est volontaire ou désagréable
en cas d'incident imprévu, et peut en témoigner. Lorsque
la lumière s'éteint, tout ce que vous apercevez est
issu de votre imagination ou a pris naissance directement sur votre
nerf optique sans passer par la case départ, c'est à
dire la rétine ! Noir c'est noir...
OBSCURITÉ : seul point commun à toutes les grottes
du globe, passé quelques dizaines de mètres de l'entrée
(distance variable suivant la topographie de la cavité) l'absence
de lumière y est totale. Rien à voir (c'est le cas de
le dire) avec une nuit sans lune. Tout spéléo en a fait
un jour l'expérience, amusante si elle est volontaire ou désagréable
en cas d'incident imprévu, et peut en témoigner. Lorsque
la lumière s'éteint, tout ce que vous apercevez est
issu de votre imagination ou a pris naissance directement sur votre
nerf optique sans passer par la case départ, c'est à
dire la rétine ! Noir c'est noir...
HYGROMÉTRIE : le degré d'humidité des
cavités est généralement très important
dans la zone tempérée et de toute façon plus
élevé qu'à l'extérieur. Il existe bien
entendu des grottes plutôt sèches, et le degré
d'humidité varie suivant la saison, les zones, la profondeur,
la circulation de l'air, la météorologie, la présence
de cours d'eaux hypogés etc. Dans les cavités de nos
régions, le taux d'humidité de l'air est souvent supérieur
à 90 % et peut parfois frôler les 100 %, ce qui permet
à certains animaux aquatiques de sortir de l'eau pour changer
de place par la voie terrestre (Niphargus). On peut rencontrer
également des animaux terrestres comme l'isopode Scotoniscus
macromelos qui peut rester noyé pendant plusieurs jours
sans décéder pour autant ! En réalité,
de très nombreux cavernicoles troglobies
sont amphibies.
TEMPÉRATURE : elle diffère notablement de celle
enregistrée à l'extérieur. Disons-le une bonne
fois, dans le monde il y a des grottes où il gèle et
d'autres où il fait plus de 20 °C. Pour autant, les écarts
de température sont toujours plus faibles qu'à l'extérieur
et le climat y est plus clément. S'il fait 0 °C dans un
aven Alpin d'altitude, il peut y avoir 10 à 20 degrés
de moins au même moment à l'extérieur, si au Nouveau-Mexique
on relève plus de 20°C dans une galerie de Lechuguilla,
le mercure peut monter à 50 °C à l'ombre des cactus
extérieurs. Dans les régions tempérées
d'Europe, la température des cavités d'altitude moyenne
tourne autour de 12 ou 13 °C, la variation de température
y est faible, voire négligeable. On peut résumer tout
cela ainsi : sous terre la température est beaucoup plus stable
qu'à l'extérieur et les écarts saisonniers ou
quotidiens nettement réduits au-delà d'une certaine
profondeur ou distance de l'entrée. C'est un phénomène
bien connu des spéléologues languedociens, en été
on est bien sous terre car il y fait frais et en hiver on y est tout
aussi bien car il y fait doux : deux bonnes raisons pour pratiquer
la spéléo toute l'année !
Par contre, les conditions de vie actuelles peuvent être bien
différentes de ce qu'elles furent par le passé. Il ne
faut pas oublier que si des cavités qui semblent aujourd'hui
favorables au développemnt des animaux cavernicoles en sont
totalement dépourvues, l'origine de ce phénomène
remonte parfois bien loin. Les grottes ne sont pas peuplées
au-delà d'une certaine latitude qui correspond sensiblement
à l'extension des glaciers au cours des deux dernières
glaciations de notre ère (Mindel et Würm). Les glaces
venant du Nord ont détruit leur peuplement sur l'ensemble du
globe. Pour d'autres raisons, évolutives celles-là,
il n'existe pas d'animaux cavernicoles troglobies
dans les cavités des régions tropicales africaines ou
asiatiques où on ne rencontre quasiment que des troglophiles.
Pour terminer, ajoutons que si aucune plante verte ne peut pousser
loin de l'entrée des cavernes (par conséquent aucun
herbivore n'y vit), la nourriture pour les cavernicoles ne manque
pas. Tout d'abord la densité de population n'est pas énorme
(mis à part dans les tas de guano où ça grouille
vraiment), ensuite l'eau y entraîne suffisamment de matière
organique pour repaître les troglobies. Je ne vous parle même
pas des myriades de bactéries contenues dans l'argile ! Inutile
donc de laisser traîner vos casse-croûtes à peine
entamés pour nourrir les aphaenops. N'oubliez jamais que les
animaux cavernicoles se nourrissent sous terre sans vous depuis des
lustres avec ce qui leur vient naturellement de l'extérieur
et, qu'à défaut d'autre chose, ils peuvent faire ceinture
(certains troglobies ont des facultés particulières
pour ça) ou se dévorer entre eux puisqu'ils sont souvent
carnivores ! Par conséquent, moins nous influerons sur leur
régime alimentaire, mieux cela vaudra pour eux...
2.2) De l'ordre s'il vous plaît
!
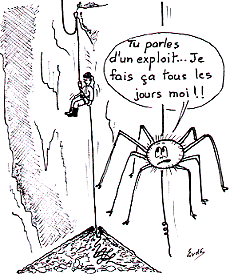 Dès qu'il fut constaté que le monde souterrain était
peuplé, faire un tri parmi tous ces êtres vivants était
devenu indispensable.
Dès qu'il fut constaté que le monde souterrain était
peuplé, faire un tri parmi tous ces êtres vivants était
devenu indispensable.
Plusieurs possibilités s'offrent à celui qui s'attaque
à cette tâche :
* classer en fonction de caractéristiques anatomiques, c'est
ce que font les systématiciens et qui permet d'associer telle
ou telle espèce à un ordre et une famille donnée,
* classer en fonction des lieux de vie préférés
des cavernicoles : l'eau, le guano, l'argile, le concrétionnement...
Des essais en ce sens eurent lieu mais le résultat n'est pas
convainquant : les animaux adultes peuvent, par exemple, vivre dans
une zone de la caverne totalement différente du stade larvaire
de la même espèce. Pourtant il reste intéressant
d'étudier les différents écosystèmes souterrains
: zone d'entrée -faiblement éclairée- des cavités,
les tas de guanos grouillants de vie, les mélanges de pierre,
d'argile et les parois stalagmitiques, l'eau souterraine libre et
enfin le milieu interstitiel noyé de la nappe phréatique.
Dans chacune de ces parties on retrouvera préférentiellement
tels ou tels types d'animaux, comme par exemple dans la zone d'entrée
dont le biotope a été étudié en détails
et auquel a été donnée le nom d'association pariétale
par R. JEANNEL.
* classer en fonction de la faculté à vivre exclusivement
ou non dans le monde hypogé.
Cette dernière méthode s'est affinée au fil
des ans pour être actuellement reconnue comme la plus pratique
en biospéologie. Comme nous le disions ci-dessus au 1.2), trois
catégories de cavernicoles sont définies par l'étroitesse
de leur lien au monde souterrain profond : trogloxènes,
troglophiles et troglobies.
Les spéléologues, à l'instar des chiens de chasse
ou des crapauds tombés par inadvertance dans des avens, ne
font partie d'aucune de ces catégories. Nous ne sommes que
des visiteurs accidentels ou volontaires du monde souterrain, pas
des cavernicoles !
2.3) Les trois catégories de cavernicoles.
2.3.1) les TROGLOXENES
Ce sont des animaux qui utilisent, quand cela est possible, le
monde souterrain au cours d'une partie de leur existence pour des
raisons particulières à chaque espèce. Les
caractéristiques physiques des cavités leurs sont
temporairement favorables, par exemple, pour hiberner (ours et chauve-souris),
pour estiver (batraciens des pays chauds) ou tout simplement pour
s'abriter (serpents, rongeurs). Ces animaux peuvent trouver ailleurs
des conditions semblables (semi-obscurité, température
stable...) et utiliser d'autres lieux en l'absence de cavités.
De plus ces animaux n'effectuent pas leur cycle complet de reproduction
sous terre : même les espèces de chauves-souris qui
utilisent les grottes comme nursery s'accouplent à l'extérieur
à
une autre période de l'année.
2.3.2) les TROGLOPHILES
Ces animaux, bien que très
peu différents morphologiquement des formes épigées,
sont particulièrement bien adaptés à la vie
souterraine. Au cours de l'histoire de leur lignée sont apparus,
suite à la variabilité génétique, des
caractères qui les ont rendus plus aptes que d'autres à
la vie dans les conditions spécifiques du monde souterrain.
C'est ce qu'on appelle la préadaptation.
| Préadaptation qu'ès aco
?!
Laissons, pour quelques lignes, les références
sérieuses et voyons comment Doc Carbur pourrait nous
éclaircir ce concept...
Imaginez que votre club manque de membres et que vous ayez
décidé de convertir à la spéléo
deux de vos amis. Le premier, Édouard, est retraité
de la marine marchande, passionné de modélisme,
Breton, grand, corpulent, myope, claustrophobe et sujet au
vertige. Le second, Alfred, de taille moyenne, svelte, nyctalope,
est originaire de l'Ariège, il collectionne les minéraux
et a exercé un temps la profession de grutier.
A votre avis, avec lequel de vos deux potes, Édouard
ou Alfred, avez-vous le plus de chance de réussir ?
La préadaptation c'est un peu ça...
Dans la population animale, un espèce possède
des centaines de gènes qui codent des milliers de protéines
et le tout s'exprime sous forme d'une quantité encore
plus grande de caractères physiques, physiologiques
ou comportementaux distincts. La variation de certains de
ces gènes n'a pas forcément d'intérêt
adaptatif particulier pour la vie épigée : on
dit qu'elle est neutre. Mais parmi ce patrimoine génétique
neutre, certains gènes peuvent apporter un avantage
adaptatif pour le milieu hypogé : il se révélera
comme une prédisposition quand, par hasard, l'espèce
animale qui porte ce caractère sera emportée
sous terre et réussira mieux qu'une autre à
s'y adapter.
Rions un peu : pour un animal, une vue faible n'est pas une
grande gène puisqu'on n'y voit rien sous terre, alors
qu'à l'extérieur, il lui sera plus difficile
de lutter contre ceux qui ont une bonne vue. Pour vos deux
amis, Édouard et Alfred, c'est plutôt le contraire
: celui qui est myope aura peur de s'égarer ou de chuter,
alors que celui qui est nyctalope pensera qu'en cas de faiblesse
de son éclairage frontal il pourra toujours retrouver
son chemin.
Décidément, les voies de le troglogenèse
sont impénétrables ! |
Certains animaux utilisent ces prédispositions pour exploiter
le monde hypogé en leur faveur, ils peuvent alors voir leur
comportement différer sensiblement de celui des membres épigés
de la même espèce : les escargots Oxychilus
épigés hibernent alors que l'Oxychilus cavernicole
troglophile a une activité constante tout au long de l'année.
Plus fort encore, si on analyse les sucs digestifs d'une espèce
d'Oxychilus épigé on s'aperçoit qu'ils
contiennent dix fois plus d'enzyme capable de digérer les
carapaces des insectes que ceux des autres escargots, et pourtant
Oxychilus épigé est détrititivore (animaux
morts, feuilles mortes) ! Et bien, devinez quoi, sous terre l'espèce
troglophile d'Oxychilus est carnivore : il mange les déchets
de carcasses d'insectes et chasse même des papillons ! Bel
exemple de préadaptation : sans cette spécificité
physiologique préalable, jamais Oxychilus n'aurait
pu donner une lignée d'animaux cavernicoles viables.
Pour autant, et même si leur cycle de vie se déroule
entièrement dans les cavités, la morphologie des troglophiles
n'a pas ou très peu évolué : peut-être
ne sont-ils pas hypogés depuis un nombre de générations
suffisamment élevé, car comme le souligne le paléontologue
S. J. GOULD : les organismes ne sont pas une pâte à
modeler que l'environnement façonne à son gré,
ni des boules de billard sur le tapis vert de la sélection
naturelle. La morphologie de ces organismes et le comportement qu'ils
ont hérité du passé exerce une contrainte et
freine leur évolution : il leur est impossible d'acquérir
rapidement de nouvelles caractéristiques optimales chaque
fois que leur environnement se modifie.. Seules les bactéries,
encore mal connues, semblent peut-être faire exception à
cette règle et avoir un pouvoir adaptatif au-dessus de la
moyenne des autres êtres vivants mais, malgré une présence
bactérienne importante dans les argiles des grottes, ceci
est une autre histoire...
2.3.3) les TROGLOBIES
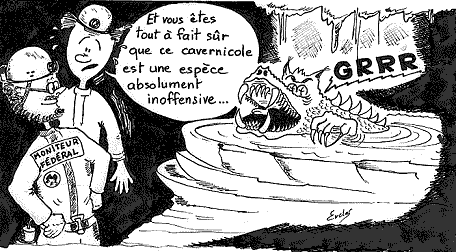 Ce sont les véritables cavernicoles qui ont surpris
les premiers observateurs par leur aspect physique, différent
de celui des animaux épigés. Bien que lointainement
issus d'animaux de surface, ils s'en sont depuis tellement éloigné
physiologiquement et morphologiquement qu'ils ne peuvent plus survivre
bien longtemps à l'extérieur. Leur développement
dépend totalement des grottes, avens, nappes phréatiques
qu'ils peuplent et auxquels on dit qu'ils sont inféodés.
Pour toutes ces raisons, ils forment de nouvelles espèces
à part entière, cousines éloignées de
celles qui vivent à l'extérieur.
Ce sont les véritables cavernicoles qui ont surpris
les premiers observateurs par leur aspect physique, différent
de celui des animaux épigés. Bien que lointainement
issus d'animaux de surface, ils s'en sont depuis tellement éloigné
physiologiquement et morphologiquement qu'ils ne peuvent plus survivre
bien longtemps à l'extérieur. Leur développement
dépend totalement des grottes, avens, nappes phréatiques
qu'ils peuplent et auxquels on dit qu'ils sont inféodés.
Pour toutes ces raisons, ils forment de nouvelles espèces
à part entière, cousines éloignées de
celles qui vivent à l'extérieur.
Il n'existe donc pas d'herbivores troglobies puisqu'il n'y a pas
de végétation chlorophyllienne dans l'obscurité
totale, pas d'oiseaux ni de mammifères (le guacharo et les
chauves-souris sont des trogloxènes), quelques rares vertébrés
(poissons, batraciens) et une foule immense d'invertébrés
(insectes, crustacés, mollusques, vers, unicellulaires).
Qu'ont-ils donc de si particulier ces troglobies ? C'est ce que
nous allons essayer de voir dans la partie 2.4).
|



