5) Anecdotes biospéologiques.
5.1 ) Un dragon nommé Olm.
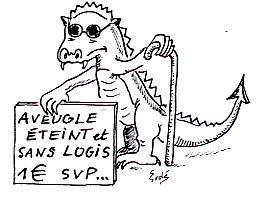 Il était une fois un facteur qui désirait s'offrir une belle
truite fario pour le repas du soir. Un peu braconnier sur les bords, il
alla briser quelques cailloux et concrétions dans la source du
ruisseau Bella, de quoi faciliter la pêche à la main d'un
beau salmonidé. Nous sommes alors à la fin du XVIIeme siècle
dans les Balkans. Au village d'Oder-Laibach, on connaît bien cette
source intermittente aux eaux fraîches et limpides : la légende
affirme qu'un dragon se baigne parfois dans les entrailles de la terre
faisant déborder l'eau de la source. Ce monstre a même un
nom : Olm !
Il était une fois un facteur qui désirait s'offrir une belle
truite fario pour le repas du soir. Un peu braconnier sur les bords, il
alla briser quelques cailloux et concrétions dans la source du
ruisseau Bella, de quoi faciliter la pêche à la main d'un
beau salmonidé. Nous sommes alors à la fin du XVIIeme siècle
dans les Balkans. Au village d'Oder-Laibach, on connaît bien cette
source intermittente aux eaux fraîches et limpides : la légende
affirme qu'un dragon se baigne parfois dans les entrailles de la terre
faisant déborder l'eau de la source. Ce monstre a même un
nom : Olm !
Revenons à notre pêcheur, après quelques instants
de désobstruction, une forte arrivée d'eau jaillit et en
lieu et place du beau poisson convoité, il découvre une
sorte de bestiole d'une vingtaine de centimètres de long, blanchâtre
et ressemblant à la fois à une salamandre et à une
anguille : un petit du dragon Olm est apparu en surface !
Environ un siècle plus tard, en 1781, J. H. LAURENTI décrira
scientifiquement ce nouvel animal, premier cavernicole à avoir
fait parler de lui, et lui donnera le nom de Proteus anguinus :
le dragon Olm vient de muer en Protée.
5.2) Lapin de Clapier farci aux petits troglobies.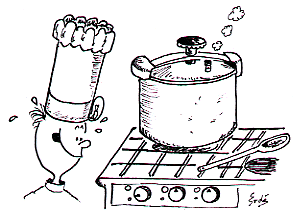
Quelle drôle de recette de cuisine que voilà
!
Un jour, pas très loin de chez nous dans l'Hérault, un
biospéologue le Docteur H. HENROT, explore la Grotte du Lapin
sur le Causse du Larzac (commune du Clapier). Sa récolte s'étant
révélé bien maigre, il décida d'y importer
plus de mille animaux cavernicoles de 6 espèces différentes
que l'on rencontre souvent dans les cavités des Pyrénées.
C'était le 27 mars 1957. En 1960 et en 1961, 4 des 6 espèces
avaient semble-t-il totalement disparu, alors que plusieurs centaines
d'animaux avaient été introduits.
Allez savoir ce qui a bien pu se passer ? La transplantation n'a pas
vraiment été couronnée de succès : pas facile
de faire aussi bien que la nature et le temps... A priori, les conditions
de vie dans la Grotte du Lapin n'ont pas été favorables
leur acclimatation, à moins que leur nombre ait été
inadapté aux refuges possibles ou à la quantité
de nourriture disponible. Quoi qu'il en soit, recréer un biotope
semble plus ardu que de réussir une bonne recette de cuisine,
avec ou sans lapin.
5.3) Accusé CASTERET levez-vous !
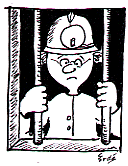 Allons bon, voilà que l'on vient ternir l'image sacralisée
de Norbert Casteret, le plus célèbre de nos spéléologues
! Manquait plus que ça... Une enquête sérieuse et
un jugement équitable s'imposent.
Allons bon, voilà que l'on vient ternir l'image sacralisée
de Norbert Casteret, le plus célèbre de nos spéléologues
! Manquait plus que ça... Une enquête sérieuse et
un jugement équitable s'imposent.
Accusé : M. Norbert CASTERET pour avoir proféré
des mensonges à la page 3, chapitre premier, de l'ouvrage Mes Cavernes.
Partie adverse : M. René JEANNEL qui l'en accuse ouvertement
en page 15, chapitre premier de l'ouvrage Les Fossiles vivants des cavernes.
Attendu que dans les faits ce sont bien les messieurs
FAUVEAU et JEANNEL qui ont, pour des raisons scientifiques, les premiers
au cours de ce XXeme siècle, pénétré dans
la rivière souterraine de Labouiche (Foix, Ariège, France);
attendu qu'ils y ont ensuite convié M. Édouard Alfred MARTEL
pour en approfondir l'exploration et ce le 2 novembre de la même
année, l'antériorité de la découverte est
bien imputable à M. JEANNEL.
Attendu que M. Norbert CASTERET écrit En 1908, l'explorateur
de cavernes E A MARTEL, qui effectuait une campagne spéléologique
dans les Pyrénées, entra dans une caverne située
à quelques kilomètres de Foix... mais ne précise
pas explicitement qu'il fut le premier à le faire, attendu que
N. CASTERET ne mentionne pas les premiers inventeurs (FAUVEAU et JEANNEL);
la cour, après en avoir délibéré, déclare
l'accusé Norbert CASTERET non coupable de forfaiture intentionnelle
mais reconnaît au Dr René JEANNEL la validité de sa
critique.
Délibération du Tribunal Virtuel de Spéléologie
Loufoque et Saugrenue en date du 28 juillet 2002.
|



